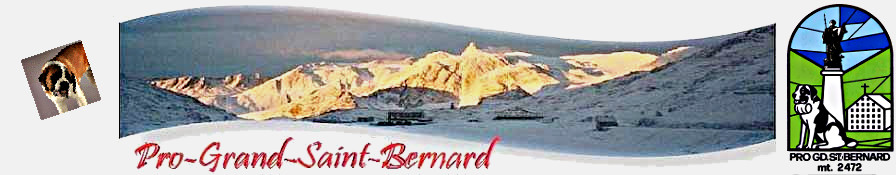Histoire du Grand St Bernard
Histoire du Col du Gd-St-Bernard et de ses habitants
Présentation extraite de ANDRE DONNET "Trésors de mon pays - Le Grand-St-Bernard", 1950
Le col au temps des Romains

Les auteurs anciens ne commencèrent à avoir des notions précises sur nos montagnes qu’au moment ou les Romains conquirent la plaine du Pô (225-22 av. J.C.) et où Hannibal franchit les Alpes pour descendre en Italie (218). Ils donnèrent le nom d’Alpes Pennines au massif qui correspond à l’actuelle appellation des Alpes valaisannes, du col de la Furka à l’est au col de la Seigne à l’ouest.
Au début de l’ère chrétienne, Tite-Live (Titus Livius- 64 au 59 a.C / -17 d.C.) s’est élevé avec raison contre l’opinion, déjà accréditée de son temps et de nos jours encore indéracinable, que cette chaîne tirait son nom de Poeni, les Carthaginois. « Je trouve fort étrange, écrit-il, qu’il y ait tant d’incertitude au sujet du col ou Hannibal franchit les Alpes et qu’on ait pu penser généralement que ce fut par les Alpes Pennines, qui tireraient alors leur nom du mot Poeni, - puisqu’il eut trouvé toutes les approches fermées à ses troupes par des peuples à demi germains. Un fait bien avéré et qui vient contredire l’opinion reçue, c’est que les Véragres, habitants de cette région, n’ont point connaissance que jamais passage d’une armée punique ait pu faire donner à leurs montagnes le nom de Pennines, ainsi appelées du dieu Penn qu’on adore sur le sommet de ces monts. »
Le Grand Saint-Bernard se nommait le Summus Poeninus ; le col lui-même, les Fores Poeninae, et le petit lac, le Penus Lacus, ou l’un des affluents de la Doire prend sa source.
Le géographe Strabon (58 av. J.C / 21-25 après J.C.) a laissé une description des routes des Alpes Grées et Pennines : « Parmi les différents chemins qui relient l’Italie à la Gaule transalpine et septentrionale, il y a celui du pays des Salasses (le Val d’Aoste moderne) qui mène à Lyon. Le chemin a deux branches, l’une qui peut être parcourue en chariot mais qui est beaucoup plus longue (le Petit Saint-Bernard), l’autre qui franchi le mont Poeninus (le Grand Saint-Bernard) et raccourcit ainsi la distance, mais qui n’offre partout qu’un sentier étroit et à pic ».

Jusqu’à la conquête romaine, ces chemins furent toujours très difficiles, très escarpés, en dépit des efforts des habitants des Alpes pour les rendre plus praticables. Une partie des indigènes, en particulier ceux qui étaient établis dans le voisinage des cols, vivaient de brigandage et, selon Strabon, se concentraient de préférence vers les sommets. C’est pour tenter de mettre à la raison ces gens que César envoya, en 57 av. J.C., son lieutenant Servius Galba chez les Nantuates, les Véragres et les Séduniens ; il « voulait dégager le chemin à travers les Alpes que les marchands avaient coutume de fréquenter à grands périls et en payant de forts péages ». Cette tentative n’eut guère de succès ; malgré les conquêtes romaines, les Salasses et autres tribus montagnardes s’y maintinrent ; Strabon précise même que « jusqu’à ces dernières années, les Salasses conservèrent une certaine puissance et continuèrent par leur brigandage à faire beaucoup de mal à ceux qui, pour franchir les Alpes, devaient passer sur leurs terres ». Auguste, enfin, parvint à les réduire définitivement dans toute une série d’expéditions qui s’échelonnent de 25 à 7 av. J.C.
A cette époque, les quatre peuples (civitates) du Valais, les Ubères, les Nantuates, les Séduniens et les Véragres, font leur soumission et sont rattachés à la province nouvelle de Rhétie et Vindélicie, constituée en 15 av. J.-C. Pendant la première moitié du 1er siècle de notre ère, Saint-Maurice parait avoir été le chef-lieu de la vallée tout entière ; mais dès le règne de Claude, avec l’octroi du droit latin aux Véragres et la fondation du Forum Claudii Vallensium à Martigny, c’est Octodure qui acquiert la prépondérance et devient le foyer de l’influence romaine et le siège administratif du Valais unifié.
Située en outre au carrefour de routes importantes, la ville constitue alors un centre, dont les fouilles n’ont pu révéler que partiellement l’étendue. Octodure a en effet disparu au cours des siècles, victime de destructions et surtout d’incendies ; le bourg médiéval, puis la ville moderne ont recouvert, et souvent rasé pour de nouvelles constructions, la plupart des vestiges de l’époque romaine. On a pu toutefois en déterminer divers quartiers, avec des édifices non seulement au forum ou autour du forum, mais encore sur une autre place ornée de portiques. Le forum qui mesure 105 m. et la grande basilique (61 x 34 m.) avec ses magasins-portiques, font apparaître à nos yeux le développement qu’avait pris la ville. Joignez l’amphithéâtre, qui n’a jamais été complètement exploré, et destiné, selon Simonett, à 6000 spectateurs.

De l’autre côté de la montagne, Auguste avait fondé, en 25 av. J.-C., la cité d’Aoste (Augusta Praetoria), sur le grand camp retranché qui renfermait l’antique Cordèle, capitale des Salasses. Siège de 3000 prétoriens chargés de tenir la vallée entière sous le joug de Rome et d’entretenir les routes, elle devint une place militaire importante. Plus favorisée qu’Octodure, elle a conservé presque intacts ses remparts qui formaient un quadrilatère d’environ 700 m. de longueur sur 600 de largeur. Les imposantes portes prétoriennes, l’arc de triomphe d’Auguste, des vestiges de l’amphithéâtre et du théâtre, du forum, constituent aujourd’hui encore les témoignages sensibles de sa grandeur.
Le trafic de la route qui, par le Summus Poeninus, reliait Rome aux provinces transalpines, contribua à la prospérité du pays durant tout l’Empire. Auguste, qui restaura les chemins des Alpes et leur donna toute la largeur possible, en fit, le premier, une chaussée praticable aux animaux de bât, sinon aux chars. Sur le versant sud, pour atteindre le sommet du col, on avait taillé dans le roc, sur une longueur d’une cinquantaine de mètres, une route en zigzag, large de 3 m. 70 ; on y voit encore, dans sa partie inférieure, les traces de marches destinées à faciliter l’accès aux bêtes de somme. On aperçoit aussi en certains points, à la base du rocher, des trous qui, selon Ferrero, devaient recevoir l’extrémité de poutres supportant un plancher, posé pour aplanir la voie ravinée par les eaux et la neige. Sur le plan supérieur, la voie passait devant le sanctuaire romain, puis gagnait le bord du lac et descendait sur le versant nord au fond de la combe : son tracé est probablement celui de l’ancienne route qui est encore visible. Par la suite, elle fut l’objet de soins particuliers ; Claude la fit paver en 47 après J.-C. Elle était si bien construite que vingt-deux ans plus tard, les troupes romaines du légat Alienus Caecina franchirent le Mont Joux à la saison de la fonte des neiges et des avalanches sans éprouver aucun accident sérieux.
Sur le col s’élevait, à 2464 m., un petit sanctuaire dédié à Jupiter Penninus, qui avait succédé à la divinité gauloise Penn. C’était un modeste temple "in antis", aux fondations creusées dans le roc ; le toit était recouvert de tuiles et décoré d’acrotères en terre cuite ; le sol était revêtu de dalles de marbre ; tout autour on avait égalisé le rocher.
Au nord-ouest et à l’ouest du temple, se dressaient deux bâtiments : les habitations des gardiens du temple et la mansio, c’est-à-dire un abri sommaire destiné aux voyageurs et à leurs montures. Passaient alors au Mont Joux des militaires en déplacement, des marchands, de riches particuliers allant visiter leurs terres, et des fonctionnaires ; tous, en déposant des ex-voto, cherchaient à s‘assurer les faveurs du dieu de la montagne.
Il est probable que ces constructions romanes subsistèrent jusqu’à la fin du 4e siècle. En tout cas, lorsqu’il fait l’éloge de sa piété, dans la Cité de Dieu, saint Augustin félicite Théodose ( 395) d’avoir fait abattre les idoles de Jupiter établies sur les Alpes...
L’hospice à Bourg-Saint-Pierre
Dès lors et pendant de nombreuses années, il semble que la montagne a été déserte.
A la fin de l’Empire, les Barbares se mettent en route ; l’arrivée des Huns en Europe provoque un ébranlement qui, communiqué de proche en proche, va gagner jusqu’aux plus lointaines contrées de la Germanie occidentale. En 443, les Burgondes s’établissent en Savoie dont Aétius leur avait ouvert l’accès ; ils ne tardent pas à s’étendre au nord, dans la partie occidentale de la Suisse actuelle ; il est plus que probable qu’ils ont occupé d’abord le Valais. En 534 a lieu la conquête, puis le partage du royaume burgonde par les fils de Clovis. Les rois francs utilisent bientôt les Burgondes dans les expéditions qu’ils entreprennent au delà des Alpes, jusqu’au moment où les Lombards occuperont la péninsule et déborderont de là sur les Gaules.

Sous les Carolingiens, la voie du Mont-Joux est, avec celles du Mont-Cenis et du Septimer, une des trois bonnes routes à travers les Alpes ; elle est aussi la plus importante, et semble avoir été par excellence celle du commerce. Elle possède déjà des cluses, c’est-à-dire des postes fortifiés. A son retour d’Italie, Charlemagne établit sur tous les cols alpins des fonctionnaires, à la fois percepteurs de tonlieu et agents de sûreté chargés d’examiner tout ce qui s’y passe.
C’est à cette époque seulement qu’on voit apparaître un nouveau refuge, à savoir un hospice et même un monastère, peut-être de Bénédictins. Ceux-ci se sont établis, non plus sur le col, mais au pied de la montagne, à l’emplacement de l’actuel village de Bourg-Saint-Pierre. Ce monastère est composé de moines dont les fonctions et les titres sont semblables à ceux qui existent à l’hospice moderne : on trouve à sa tête un abbé (ce sera plus tard un prévôt assisté d’un aumônier qui est chargé de soigner les pauvres et de restaurer les pèlerins ; à l’issue du 9me siècle, il est déjà fait mention des marronniers (maron, marron, guide de montagne), qui ont pour tâche de rechercher les voyageurs en difficulté dans la montagne et de les aider à la franchir.
L’hospice de Saint-Pierre de Mont-Joux est propriété royale. On connait quelques-unes de ses possessions dans le Pays de Vaud ; elles ne sont sans doute que les mailles visibles d’un réseau beaucoup plus étendu ; car, placé sur la route la plus fréquentée qui reliait le Sud au Nord, le monastère offrit l’hospitalité à des papes, des empereurs, des rois, des princes, à une foule de pèlerins, dont beaucoup témoignèrent leur reconnaissance par des donations.
Si nous ignorons dans quelle mesure les Hongrois ravagèrent la Bourgogne, nous savons par contre que les Sarrasins avaient, au 10ème siècle, poussé très loin leurs expéditions dans les Alpes, jusqu’au jour où la capture de saint Mayeul, abbé de Cluny, mit en branle les forces régulières qui accélérèrent le rythme de destruction des envahisseurs, déjà en guerre entre eux et avec les indigènes pour la possession des terres. Leurs dévastations avaient atteint l’église de Bourg-Saint-Pierre que Hugues II, évêque de Genève, fit reconstruire au début du 11ème siècle ; nous ne savons si l’abbaye a subi le même sort et fut également reconstruite. Que Rodolphe III la donne en 1011 à son épouse Ermangarde, n’implique pas nécessairement l’intégrité de l’édifice, car les dépendances du monastère représentaient déjà à elles seules une réelle valeur ; mais ne semble-t-il pas aussi probable que l’abbaye ayant subi le même sort que l’église, Rodolphe confie à sa femme le soin d’en relever les ruines ? En tout cas, un itinéraire anglais (vers 990), qui énumère les stations de Rome à la Manche, en passant par le Mont-Joux, ne fait état d’un hospice ni sur le col ni à Bourg-Saint-Pierre ; en outre, quand il mentionne le passage d’un corps de Normands vers 1020, Raoul Glaber laisse entendre qu’à cette époque, on ne rencontrait plus de refuge sur la montagne, et qu’au brigandage des Sarrasins avaient succédé les vexations des rançonneurs de grands chemins qui tenaient les cluses et molestaient les voyageurs et les pèlerins.
La fondation de l’hospice sur le col du Mont-Joux.

Chacun connait la « merveilleuse histoire de saint Bernard de Menthon » : ce jeune homme, issu d’une famille illustre qui se rattache à Olivier, pair de France et comte du Genevois, manifeste dès sa plus tendre enfance les dispositions les plus étonnantes ; il médite déjà de renverser les statues de Jupiter érigés au Mont-Joux et à Colonne-Joux. Il commence à enseigner la théologie quand son père, qui lui a choisi une épouse, le rappelle au château de Menthon, en Savoie. La veille de ses noces, Bernard qui ne veut pas embrasser l’état du mariage, se retire dans sa chambre pour se livrer à l’oraison ; saint Nicolas lui apparaît en songe et lui ordonne de se rendre à Aoste où l’archidiacre Pierre aura soin de sa vocation ; laissant un message pour prévenir ses parents de sa détermination, Bernard s’enfuit à la faveur de la nuit et se hâte vers Aoste par des chemins détournés. Il entre au Chapitre et à la mort de l’archidiacre lui succède dans son office. A l’instigation de saint Nicolas, il entreprend bientôt de réduire au silence le démon établi sur la montagne ; il l’abat dans un combat merveilleux, puis fonde en plein 10ème siècle, un hospice-monastère sur le Mont-Joux et un second à Colonne-Joux. Cependant, les parents de Menthon, minés par le chagrin, finissent par retrouver leur fils. Le saint meurt à Novare en 1008, âgé de quatre-vingt-cinq ans, ayant accompli quarante ans d’archidiaconat...
Mais cette « merveilleuse histoire », habilement propagée dès le 15ème siècle, grâce surtout au « Mystère de saint Bernard de Menthon », et à laquelle la pièce d’Henri Ghéon a donné un regain de popularité, n’est qu’une légende. En dépit des travaux des historiens qui ont suffisamment démontré qu’il a pour source « un faux bien caractérisé », ce récit conserve encore aux yeux des fidèles une grande valeur sentimentale. En réalité, on est beaucoup moins bien informé. On sait tout au plus que saint Bernard était un noble valdôtain ; qu’il fut archidiacre d’Aoste ; que, peu avant sa mort en 1081, il rencontra à Pavie l’empereur Henri IV qui marchait sur Rome pour ruiner la puissance du pape Grégoire VII. Quant à l’origine de I’hospice, on ne possède guère plus de précisions ; il n’existe pas de charte de la fondation, qui est toutefois attestée par de nombreux documents. Un manuscrit peu connu du 15ème siècle, à Verceil, qui contient une vie de saint Bernard, nous en a transmis un récit très sobre.
« Un jour, saint Bernard traversa une montagne où autrefois les habitants rendaient un culte à Jupiter dans son temple. Il y avait là une multitude de mauvais esprits, et l’un d’eux molestait les voyageurs ; dans les régions voisines, avec la permission de Dieu — les péchés des habitants l’exigeaient — les anges mauvais provoquèrent des rafales funestes de tempêtes. L’homme de Dieu voyant l’affliction des habitants commença à leur parler de la miséricorde de Dieu et de sa sévérité à l’égard des pécheurs. Lors de sa prédication, touchés aux larmes, tous lui dirent « Ordonne ; quoi que tu commanderas, nous obéirons à tes préceptes pourvu que la colère de Dieu se détourne de nous. » Le saint leur ordonna un jeune de trois jours, et le peuple fit pénitence... Et peu de jours après qu’il se fut lui-même adonné au jeune et à l’oraison, le saint, muni du signe de la croix, se porta vers le lieu fameux. Lorsque le démon, rugissant et horrible à voir, vint au-devant de lui, l’homme de Dieu le saisit aussitôt et lui ordonna de se taire ; le démon se laissa lier comme un petit animal ; le saint le conduisit alors en un lieu désert et lui ordonna, au nom de la Sainte Trinité et de Jésus-christ, de ne plus jamais nuire à personne ; une fois le temple de Jupiter ainsi débarrassé, ce lieu retrouva la paix ; et jusqu’à ce jour, en cet endroit où un monastère fut construit, il accourt beaucoup de voyageurs envers lesquels on exerce aussi les devoirs de l’hospitalité... »
Ce récit, il est vrai, ne parle pas expressément de brigands ; mais il n’est pas impossible que les gens du pays aient considéré les bandes qui occupaient le passage comme des démons, de mauvais esprits, de mauvais anges ; pour peu que Ies brigands aient joint à leurs opérations la moindre sorcellerie, on imagine aisément leur emprise sur les habitants et la complicité de terreur par laquelle ceux-ci se trouvaient liés
.On peut donc supposer que ce sont leurs plaintes qui ont déterminé saint Bernard, archidiacre d’Aoste, à débarrasser le col des rançonneurs qui avaient trouvé un refuge tout indiqué dans les ruines du temple de Jupiter et de la "mansio" romaine, et à remplir une des fonctions de sa charge, celle de protéger les pauvres et les malheureux, en assurant, par la construction d’un hospice, la sécurité de ce passage très fréquenté.
Ce qui est certain, c’est que saint Bernard ne reconstruisit pas le monastère de Bourg-Saint-Pierre, dont le moine islandais Nicolas Saemundarson aperçut encore Ies ruines au 12ème siècle. Il établit l’hospice, vers le milieu du 11ème siècle, sur le col même, et dominant la pente très raide de la Combe des Morts, sur le versant valaisan ; malgré le rude climat de cet emplacement, il est réellement "in loco et passagio melius apto" il a toujours échappé au danger des grandes avalanches.
Saint Bernard toutefois n’éleva pas un bâtiment comparable à celui que l’on connait de nos jours. Nous savons maintenant, grâce à une remarquable étude archéologique de M. Louis Blondel, que le saint édifia une maison fort simple avec, pour lui-même et ses compagnons, « de petites logettes ». C’étaient des huttes en pierre, voûtées, semblables aux refuges de haute montagne, tels qu’on en rencontre dans les alpages des alentours, dans le val d’Entremont. Une de ces cellules, dite « grotte de la récollection de saint Bernard », subsiste encore, révérée comme le plus ancien témoin de l’hospice sur le col.
La maison primitive, dont on a conservé les fondations, peut dater de la fin du 11ème siècle ; c’était une forte bâtisse, aux murs épais ; elle se composait d’un rez-de-chaussée comprenant trois grandes salles réfectoire et cuisine, chauffoir, et corridor en face de l’entrée principale surmontée d’une tour qui, plus tard, formera clocher ; dans urne tourelle en saillie, un escalier donnait accès au premier étage, où se trouvaient l’hospice (dortoir), la petite chapelle de Saint-Michel, et les logements des religieux.
L’église de l’hospice est mentionnée pour la première fois en 1125, sous le vocable de saint Nicolas. En cela, saint Bernard n’a fait que suivre un exemple courant de son époque ; au 11ème siècle, on constate en effet un développement rapide du culte de ce saint, patron des marchands ; les églises qui lui sont dédiés jalonnent toutes la route des marchands et des pèlerins qui conduit d’Italie par le Mont-Joux au bassin de la Seine supérieure. On peut en outre soupçonner une relation entre la consécration de l’hospice à saint Nicolas et les fréquents passages du pape Léon IX en 1049 et 1050. Ce n’est qu’un siècle plus tard qu’on y adjoindra le nom de saint Bernard, qui persistera dès lors tout seul.
Quant à la communauté qui desservait l’hospice, il serait prématuré de conclure qu’elle fut constituée, alors déjà, selon la règle de saint Augustin. « Il est plus que probable, remarque le P. de Gaiffier, bollandiste, que la fondation de saint Bernard doit être comparée à ces nombreuses institutions, mi-laïques, mi cléricales, qui n’étaient inféodées à aucune des formes traditionnelles de la vie religieuse et qui n’ont trouvé que peu à peu une organisation régulière et des statuts canoniques, la plupart du temps en s’affiliant à des Ordres plus anciens. »
L’institution établie, il lui fallait des revenus pour assurer l’hospitalité. On peut supposer qu’elle en trouva tout d’abord dans les biens de l’ancienne abbaye de Saint-Pierre de Mont-Joux, à laquelle elle succède en quelque sorte. Sans doute, la liste des dons à la nouvelle maison ne s’ouvre-t-elle dans Ies chartes qu’en 1125. Mais une bulle du pape Alexandre III, datée de Venise en 1177, qui prend sous sa protection l’hospice et confirme déjà ses possessions, en énumère près de quatre-vingts, disséminées en Suisse, en Italie, en Sicile, en France et en Angleterre ; elles n’ont pas surgi tout d’un coup du néant ; elles se trouvent sur les principales routes parcourues par les marchands du moyen âge. Il serait intéressant de pouvoir se rendre compte à la suite de quelles circonstances, dans quel ordre, elles ont été fondées ; car, grâce à sa situation privilégiée sur une voie très fréquentée, l’hospice du Mont-Joux joua encore le rôle d’intermédiaire pour une nouvelle expansion du culte de saint Nicolas au nord-ouest des Alpes.
Au cours du Moyen-Âge
La voie du Mont-Joux était non seulement une route commerciale entre le Nord et le Sud ; elle était aussi une artère principale du pèlerinage de Rome. « Depuis des siècles, écrit E. Mâle, Rome et le Tombeau des Apôtres mettaient en mouvement les foules. En été, quand revenaient les longs jours, quand le passage était facile au gué des rivières, les pèlerins descendaient des Alpes. »Le col était une des portes de l’Italie « Par les monts de Monjeu ou moult a fort passage ». C’est par cette voie, selon la Chevalerie Ogier au 12ème siècle, que Charlemagne était descendu en Lombardie quand il était ailé délivrer Rome des Sarrasins...
Grâce aux pèlerins, la renommée du nouvel hospice ne tarda pas à s’étendre rapidement dans toute la chrétienté ; ainsi le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, écrit en France vers 1139, le mentionne déjà parmi Ies trois grands hospices du monde :

« Trois colonnes nécessaires entre toutes au soutien des pauvres ont été établies par Dieu en ce monde l’hospice de Jérusalem, l’hospice du Mont-Joux et l’hospice de Sainte-Christine sur le Somport. Ces hospices ont été installés à des emplacements où ils étaient nécessaires ; ce sont des lieux sacrés, des maisons de Dieu pour le réconfort des saints pèlerins, le repos des indigents, la consolation des malades, le salut des morts, l’aide aux vivants... »
Les empereurs d’Allemagne, les papes, les rois d’Angleterre, les comtes de Savoie se disputèrent la gloire de contribuer à la prospérité d’une fondation aussi utile à la chrétienté. Les évêques et les prélats voisins réunirent au monastère de nombreux bénéfices. En beaucoup d’endroits, pour témoigner leur reconnaissance, des voyageurs fondaient de nouveaux hospices qu’ils donnaient au Mont-Joux et qui allaient jalonner les routes des pèlerins, tel celui de Salins, en Franche-Comté.
Les ressources affluaient. C’est alors, dans le courant du 13ème siècle, que le premier noyau des constructions de l’hospice a été augmenté d’un tiers, au nord et à l’ouest.
Cette multitude de bénéfices et de propriétés ne tarda pas à amener un relâchement dans la discipline ; en outre, le prévôt vivait éloigné de ses religieux, tantôt à Rive (Thonon), tantôt à Etoy (Vaud). Un décret du Chapitre général de 1333 sanctionnait déjà un état de fait « Il a été reconnu que suivant la coutume immémoriale et la très antique constitution, les religieux de Mont-Joux ont toujours été et toujours seront en droit de disposer de leurs acquêts, selon leur bon plaisir et pleine volonté. »
On voulait dès lors, en effet, ne plus admettre à la profession que des religieux pourvus de riches patrimoines, dont ils pouvaient disposer à leur gré, et testant sous la seule réserve de la juste part due au prévôt.
Jean d’Arces, prévôt (1417-1438), voyant s ‘aggraver cet état de choses et voulant mettre un frein aux abus, établit un plan de réforme qu’il fit approuver dans deux Chapitres de 1437. La première partie de ce plan avait trait à l’économie religieuse et hospitalière ; la seconde, aux abus et transgressions qu’on espérait pouvoir corriger. Les religieux ne doivent « ni s ‘adonner à la chasse, ni danser, ni rire haut, ni jouer, ni fréquenter les tavernes, ni chanter ce qui est contre la règle... , ni porter habits, houppes de vives couleurs, ni robes à boutons, crochets, larges manches, ou chausses si étroites et si bigarrées, que ceux qui les portaient n’étaient pas mieux couverts qu’Adam et Eve sous Ies feuilles du figuier. Défense d’avoir du linge fin, et de faire saillir le collet de la chemise sur l’ourlet de la tunique... de porter des armes à feu, des couteaux de chasse, tabatières d’argent... ; d’aller aux Lieux-Saints sans permission... »

« On portera la tonsure selon les ordres reçus... ; on n’imitera plus les Grecs, on coupera donc les cheveux tout courts... On établira des examinateurs, directeurs, pour réformer, corriger, punir et instruire les religieux, qui ne savent ni chanter, ni lire, ni administrer les sacrements, pas même prononcer les paroles de la Consécration... »
Mais Jean d’Arces se retira aussitôt, pour accéder en 1438 à l’archevêché de Tarentaise. On fit alors un sort à la nouvelle Constitution qui ne fut plus regardée que comme une loi tortionnaire ; elle tomba dans un tel oubli qu’on ne la vit reparaître que deux siècles plus tard.
Dès 1437, le pape Eugène IV s’était réservé la nomination des prévôts ; mais son successeur, Nicolas V, concéda un droit de désignation à la Maison de Savoie. Sous le régime commendataire, c’est dès lors le règne du gaspillage et de la déprédation. En dépit de la résistance des religieux et même du Saint-Siège, en dépit des décrets du Concile de Trente, les prévôts commendataires aliénèrent un à un bénéfices et domaines. La Maison de Savoie occupa elle même le siège prévôtal de 1458 à 1509, celle de la Forêt de 1510 à 1563.
Vers la séparation (1752)
En 1555, un grand incendie détruisit les toits et le haut des murs de l’hospice. Malgré les réclamations des religieux qui devaient vivre dans des conditions déplorables, les restaurations ne furent entreprises que trois ans plus tard. « On se contenta, remarque M. L. Blondel, de déblayer les ruines, de remonter le haut des murs, de construire de grands contreforts ou ogives contre les façades, de reblanchir et recrépir les salles et l’église, enfin de refaire les toits en les couvrant de grandes pierres ou "loses". Après la première étape des travaux, on construisit une paroi en planches pour fermer une des façades entr’ouverte afin de mettre la maison à l’abri de la neige. »
A cette époque, le Grand Saint-Bernard devait être protégé par des fortifications. En tout cas, sur un dessin de 1626 qui représente l’église et l’hospice, on remarque un mur crénelé passant au sud derrière les bâtiments ; il est donc vraisemblable qu’on avait édifié un rempart relié à la maison et barrant le col du coté valaisan. Sur l’autre versant, il devait également y avoir au Plan de Jupiter un mur analogue à celui qui barrait la vallée à Saint-Rhémy. On sait qu’en avril 1476, de violents combats eurent lieu entre les Valaisans, alliés aux Bernois, et les troupes du comte de Challant, au col même où les Piémontais s’étaient retranchés pour couvrir leur retraite et firent de nombreuses victimes dans la "Combe des Morts" ; les Piémontais ont sans doute utilisé une fortification déjà en place. Et la tradition rapporte que la nouvelle morgue, qui date en effet de 1476, a été construite pour déposer Ies victimes de ces combats.
Les bâtiments nécessitaient un entretien constant et de fréquentes réparations ; il en est ainsi tout au long du 17ème siècle. Mais c’est sous le règne du prévôt Antoine Norat (1671-1693) que furent exécutés les principaux travaux : il fit remanier tout l’hospice, et construire I’église actuelle, consacrée en 1689 par Adrien VI de Riedmatten, évêque de Sion ; oeuvre du maître maçon piémontais Jean-Antoine Marcoz, natif de Brissogne, elle inaugurait en même temps de belles stalles.

Pendant les trente-trois ans de son administration (1611-1644), le prévôt Roland Viot s’était appliqué à relever l’hospice, en dépit des prétentions de la Savoie à maintenir la commende. La concorde toutefois ne se rétablissait pas ; le Chapitre du Mont-Joux élisait un prévôt, et la Savoie en désignait un autre on recourait sans cesse à Rome les Valaisans soutenaient les droits du Chapitre.
Le célèbre coadjuteur du prévôt Persod (1693-1724), Louis Boniface, avait décidé alors qu’il était encore simple religieux de remettre en vigueur les Constitutions tombées dans l’oubli, et d’obtenir l’exacte observance de la Règle ; à chaque réunion du Chapitre, et malgré la résistance de quelques religieux, il revenait avec insistance et persévérance sur ce sujet. Le prévôt lui-même l’accusa d’avoir provoqué une visite de l’auditeur du nonce de Lucerne, qui arriva à l’hospice en août 1710. Ce dernier exigea de toute la communauté la signature du décret touchant les constitutions, « pour obliger chaque religieux à les observer comme ils l’ont promis "expresse et nominatim" dans la formule de leur profession ». Il s’ensuivit une scission et la création de deux partis « constitutionnaires », et « anticonstitutionnaires ».
Boniface serait sans doute parvenu à ses fins si la mort ne l’avait surpris au début de sa prélature (1724-1728) ; il aurait réussi à faire reconnaître les droits de la congrégation à la libre élection de ses prévôts et de tous les bénéfices qui en dépendent. Léonard Jorioz lui succéda (1728-1734), mais le Valais s’opposa à ce qu’il prit possession de son office ; aussi n’administra-t-il que les biens situés dans les États sardes.
A la mort de Jorioz, le roi de Sardaigne lui donna à deux reprises un successeur que le Chapitre refusa de reconnaître ; en 1749, il fit une troisième tentative qui n’eut pas plus de succès. De son côté, le pape Clément XII avait nommé en 1735 administrateur général de la prévôté le chanoine Jean-François Michellod. On proposa encore en 1750 un arrangement pour concilier les partisans et les adversaires de la Réforme ; il consistait à diviser les biens et à constituer deux hospices, l’un au Grand, l’autre au Petit Saint-Bernard. Cette tentative, demeurée sans résultat, fut la dernière.
C’est alors, en 1752, que le pape Benoît XIV fulmina la bulle dite de séparation. Elle affectait à l’ordre militaire des saints Maurice et Lazare tous les biens situés en decà des Alpes, sécularisait les religieux de la fraction anticonstitutionnelle, sujets sardes (c‘est ainsi que le Petit Saint-Bernard, qui avait été rattaché à l’hospice dès 1466, fut dévolu à cet ordre qui y établit un prêtre séculier pour exercer l’hospitalité) ; elle attribuait aux Valaisans et aux partisans de la Réforme l’hospice du Grand Saint-Bernard et ses possessions valaisannes. La bulle reconnaissait enfin aux religieux du monastère le droit de nommer librement leur prévôt.
La liberté reconquise coûtait cher au Grand Saint-Bernard ; la prévôté perdait d’un coup les trois quarts de ses membres ; elle était réduite à des ressources financières fort restreintes pour faire face aux exigences de l’hospitalité. Le diocèse d’Aoste subissait également le contrecoup de cette mesure les paroisses valdôtaines, desservies par les religieux de l’hospice, avaient été des pépinières de sujets qui se destinaient à la prêtrise et qui, leur formation achevée, revenaient exercer leur ministère dans la vallée.
De Napoléon à nos jours Du passage de Bonaparte (1800) à nos jours
François Bodmer, de la vallée de Conches, premier prévôt valaisan (1753-1758), fixa sa résidence à Martigny ; Claude-Philibert Thévenot (1758-1775) obtint de Clément XIII, en 1762, pour lui et ses successeurs, la crosse et la mitre.
Louis-Antoine Luder, élu en 1775, allait vivre des jours agités. Cette même année, en effet, un incendie parti de la cheminée de la cuisine, ouvrit les yeux sur certains dangers qui menaçaient la maison ; il appartenait au nouveau prévôt d’en perfectionner les installations ; il construisit en outre l’hôpital Saint-Louis, édifice établi sur le versant nord du col et pourvu d’un puissant éperon destiné à couper les avalanches.
On ne tarda pas à ressentir jusqu’à l’hospice les remous de la Révolution française. Alors que l’hospice se relevait lentement de la scission, les événements s ‘étaient un peu partout précipités. En Valais, c’était la fin de la République des VII Dizains par la proclamation de l’indépendance du Bas Valais, puis l’incorporation du pays à la République helvétique avec les conséquences de l’ingérence française les insurrections successives du Haut Valais férocement réprimées, Souvarof et Masséna aux prises en Suisse.

Le passage de Bonaparte en mai 1800 a frappé l’imagination des contemporains qui ont immédiatement évoqué celui d’Hannibal ; et de nos jours encore, dans le souvenir du peuple, il en demeure un écho assourdi de triomphe juvénile, grâce surtout au récit de Thiers qui, dans son Histoire du Consulat et de l’Empire, en a cristallisé, pour la postérité, la grandeur épique.
Chacun connait l’expédition étonnante de cette armée de réserve, constituée à Dijon sous le commandement nominal de Berthier, qui remporta la victoire à Marengo. Mais cédons ici la parole à un troupier, le capitaine Coignet, qui, dans ses Cahiers, a laissé un pittoresque récit de la montée à I’hospice.
« De Lausanne... on remonte la vallée du Rhône, et on arrive à Saint-Maurice. De là nous partîmes pour Martigny (tous ces villages sont ce que l’on peut voir de plus malheureux) ; on prend une autre vallée que l’on peut dire la vallée de l’Enfer ; là on quitte la vallée du Rhône pour prendre la vallée qui conduit au Saint-Bernard ; et l’on arrive au bourg de Saint-Pierre, situé au pied de la gorge du Saint-Bernard.
« Ce village n’est composé que de baraques couvertes de planches, avec des granges d’une grandeur immense où nous couchâmes tous péle-méIe. Là, on démonta tout notre petit parc, le Consul présent. L’on mit nos trois pièces de canon dans une auge ; au bout de cette auge il y avait une grande mortaise pour conduire notre pièce gouvernée par un canonnier fort et intelligent qui commandait quarante grenadiers. Avec le silence le plus absolu, il faut lui obéir à tous les mouvements que sa pièce pourrait faire. S’il disait : Halte ! il ne fallait pas bouger ; s’il disait En avant ! il fallait partir. Enfin, il était le maître.
« Tout fut prêt pour le lendemain matin au petit jour, et on nous fit la distribution de biscuits... et on nous donna deux paires de souliers. Le même soir, notre canonnier forma son attelage qui se montait de quarante grenadiers par pièce...
« ... Au point du jour, notre maître nous plaça tous les vingt à notre pièce : dix de chaque côté. Moi je me trouvais le premier devant, à droite ; c’était le côté le plus périlleux, car c’était le côté des précipices... Deux hommes portaient un essieu ; deux portaient une roue ; quatre portaient le dessus du caisson ; huit, le coffre ; huit autres, les fusils ; tout le monde était occupé, chacun à son poste.
« Ce voyage fut des plus pénibles. De temps en temps, on disait : Halte ! ou En avant et personne ne disait mot. Tout cela n’était que pour rire, mais arrivé aux neiges. la devient tout à fait sérieux. Le sentier était couvert de glace qui coupait nos souliers, et notre canonnier ne pouvait être maître de sa pièce qui glissait ; il fallait la remonter, il fallait le courage de cet homme pour y tenir. Halte !... En avant... Criait-il à chaque instant. Et tout le monde restait silencieux.

« Nous fîmes une lieue dans ce pénible chemin ; il fallut nous donner un moment de répit pour mettre des souliers (les nôtres étaient en lambeaux) et casser un morceau de biscuit...
« ... Et nous voilà partis bien chaussés de souliers neufs. Allons, mes chevaux, dit notre canonnier, à vos postes, en avant ! Gagnons les neiges, nous serons mieux, nous n’aurons pas tant de peine.
« Nous atteignîmes ces horreurs de neiges perpétuelles, et nous étions mieux, notre canon glissait plus vite. Voilà que le général Chambarlhac passe et veut faire allonger le pas ; il va vers le canonnier et prend le ton de maître, mais il fut mal revu.
« Ce n’est pas vous qui commandez ma pièce, dit le canonnier, c’est moi qui en suis responsable. Aussi, passez votre chemin ! Ces grenadiers ne vous appartiennent pas dans ce moment, c’est moi seul qui les commande.
« Il voulut venir vers le canonnier, mais celui-ci fit faire halte Si vous ne vous retirez pas devers ma pièce, dit-il, je vous assomme d’un coup de levier. Passez, ou je vous jette dans le précipice.
« Il fut contraint de passer son chemin, et nous arrivâmes avec des efforts inouïs au pied du couvent. A quatre cents pas, la montée est très rapide, et là nous vîmes que des troupes avaient passé devant nous ; le chemin était frayé ; pour gagner le couvent, on avait formé des marches. Nous déposâmes nos trois pièces et nous entrâmes quatre cents grenadiers, avec une partie de nos officiers, dans la maison de Dieu où ces hommes dévoués à l’humanité sont pour secourir tous les passagers et leur donner l’assistance. Leurs chiens sont toujours en faction pour guider les malheureux qui pourraient tomber dans les avalanches de neige et les reconduisent dans cette maison ou l’on trouve tous les secours dus à l’humanité. Pendant que nos officiers et notre colonel étaient dans les salles avec de bons feux, nous recûmes de ces hommes vénérables un seau de vin pour douze hommes, un quarteron de fromage de Gruyère et une livre de pain ; on nous mit dans des corridors très larges. Ces bons religieux nous firent tout ce qui dépendait d’eux, et je crois qu’ils furent bien traités. Pour notre compte, nous serrâmes les mains de ces bons pères en les quittant, et nous embrassions leurs chiens qui nous caressaient comme s’ils nous connaissaient. Je ne puis trouver d’expressions dans mon intelligence pour pouvoir exprimer toute la vénération que je porte à ces hommes ... »
Après Marengo, Le Premier Consul mit bientôt à exécution son projet d’ouvrir, entre la France et L’Italie, par le Simplon, une route commerciale et stratégique, plus courte et plus sure. Mais comme son passage par le Grand Saint-Bernard en 1800 lui avait démontré les avantages d’un hospice sur les cols des Alpes, il décida la construction de deux maisons identiques, l’une au Mont-Cenis, l’autre au Simplon, et en établit supérieur général le prévôt du Mont-Joux. L’hospice du Simplon, que les mêmes religieux desservent encore de nos jours, fut doté par le gouvernement français et occupa, en attendant la construction du bâtiment, l’ancien hospice Stockalper.
Le règne de Napoléon fut encore marqué par la réunion momentanée, mais qui ne fut jamais effective, de l’Abbaye de Saint-Maurice à l’Hospice du Grand Saint-Bernard.
Après 1815, tout rentra dans l’ordre ; mais la maison n’était pas au terme de ses épreuves. En effet, si, de 1821 à 1827, le prévôt Genoud fit procéder à l’agrandissement du monastère, surélevé d’un étage, dont la dépense fut en partie couverte par une souscription publique, et achever l’hospice du Simplon, le Grand Saunt-Bernard subit encore le contre-coup de la défaite du Sonderbund et fut, un temps, sous le prévôt Filliez, privé de ses revenus.
La Communauté
La congrégation des chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard est actuellement dirigée par Sa Révérence Mgr Benoit Vouilloz (élu en 1992), prévôt mitré et crossé ; elle compte plus de cinquante membres (chanoines, novices et frères laic).
Elle dessert l’hospice du Grand Saint-Bernard. Sous la direction du prieur claustral, quatre chanoines y remplissent les fonctions de Père-maitre, ou maître des novices, de sacristain, préposé au service de l’église, de clavandier, qui détient les clefs et veille aux approvisionnements, et d’aumônier, chargé de recevoir les voyageurs et de distribuer les secours. Il y a peu de temps encore, Ies jeunes religieux accomplissaient le cycle de leurs études de philosophie et de théologie à l’hospice même, sous la direction de leurs aînés ; l’enseignement de la théologie se donne désormais à Fribourg.
Elle dessert également l’hospice du Simplon, administré par un prieur aidé de quelques chanoines.
En outre, neuf paroisses du diocèse de Sion sont incorporées à la prévôté ; ce sont : Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher, Bovernier, Martigny, Trient, Lens et Vouvry.
Les bâtiments
L’hospice s’élève à 2473 m. au-dessus de la mer. Il est sur territoire valaisan, séparé de l’Italie par le petit lac. Les bâtiments actuels sont au nombre de quatre :
l’hospice lui-même avec l’église attenante, la morgue, l’hospice Saint-Louis, enfin l’hôtel de 180 lits construit en 1898.
Un perron introduit le voyageur dans le vestibule de l’hospice. Une inscription y rappelle la reconnaissance du Valais (1804) à l’égard de Bonaparte qui érigea le pays en République indépendante (1802-1810).
La plus grande partie du bâtiment est affectée aux chambres et aux dortoirs destinés aux voyageurs. L’hospitalité est entièrement gratuite, pour tous en hiver et pour les pauvres en été ; seul un tronc discrètement posé dans un coin du vestibule invite les passants à verser leur obole. Au premier étage, à l’ouest, se trouvent les locaux réservés aux religieux et fermés par la clôture.
L’église est un lieu de pèlerinage fréquenté ; chaque jour, les religieux y chantent la messe et psalmodient l’office. Décorée de fresques et de stalles du 17ème siècle, elle est dédiée aux saints Nicolas et Bernard ; divers autels sont consacrés à saint Bernard, à saint Augustin, à sainte Faustine, etc. En entrant, à gauche, on remarque le monument érigé par Bonaparte à la mémoire de Desaix, mort à Marengo. La sacristie abrite le trésor et les archives. La bibliothèque, disposée sous les combles, comprend plus de 30 000 volumes, dont un grand nombre de revues. Le musée s’ouvre au rez-de-chaussée de l’hospice, non loin de l’entrée il offre à la curiosité des touristes une riche collection numismatique, une collection encore plus riche d’insectes recueillis dans la montagne, et de nombreuses antiquités romaines, découvertes pour la plupart lors des fouilles effectuées à la fin da 19ème siècle sur l’emplacement dit temple de Jupiter ; il faut aussi signaler quelques manuscrits enluminés, quelques incunables, des documents se rapportant à l’iconographie de saint Bernard et de l’hospice, et enfin une superbe collection d’étains.
Les chiens

On ne saurait décrire l’hospice sans mentionner les chiens qui, hélas ! pour les cohortes de touristes modernes, paraissent en constituer la principale attraction.
Ils apparaissent pour la première fois, semble-t-il, au milieu du 17ème siècle, dans un tableau attribué à Salvator Rosa. On ne sait rien de leur origine. Les cynologues n’ont pas réussi à se mettre d’accord ; les uns prétendent que les chiens du Saint-Bernard appartiennent à une race intermédiaire entre le dogue anglais et l’épagneul ; d’autres, qu’ils proviennent du croisement d’un danois avec une chienne de berger du Valais.
Quoi qu’il en soit, ce sont des chiens grands et forts, à la robe fauve ou marron avec des taches blanches, aux poils courts et épais ; leur tête est puissante, les pattes énormes. La meute se compose ordinairement de douze à quinze sujets.
Si autrefois les chiens ont rendu de grande services pour assister les marronniers à la recherche des voyageurs égarés dans la montagne ou épuisés par l’effort, on ne continue plus de nos jours leur élevage que par tradition ; leur utilité a sensiblement diminué depuis l’installation du téléphone et surtout depuis l’apparition des skis. Par conséquent le dressage est désormais sans objet.
Les chiens accompagnent les religieux dans leurs randonnées aux alentours de I’hospice et leur servent encore de guides dans le brouillard.
Adaptation de l’hospitalité
La vie moderne qui a singulièrement perfectionné les communications n’a pas laissé de porter atteinte aux buts d’un hospice fondé au 11ème siècle pour le réconfort des pèlerins, le repos des indigents, la consolation des malades .
En effet, la construction d’une belle route, la multiplication des moyens de locomotion ont amené au Grand Saint-Bernard, depuis le début du siècle, une foule sans cesse croissante de touristes. En juillet et en aoùt, d’innombrables cars et automobiles déversent sur la place du col des nuées de ces nouveaux pèlerins . De dix heures du matin à trois heures de l’après-midi, l’hospice doit mobiliser tout son personnel pour endiguer ces flots de touristes impétueux qui se ruent à l’assaut de la maison et à la curiosité indiscrète desquels aucune porte, pas même celle de la clôture, ne constitue un obstacle.
Le percement du Simplon, en 1905, a également fait perdre à l’hospice établi sur le col son importance primitive.
C’est la raison pour laquelle, fidèles à l’esprit de leurs Constitutions, et coopérant ainsi à l’oeuvre d’évangélisation de l’Asie, les religieux, réunis en Chapitre général, ont décidé à l’unanimité, en 1933, la fondation d’une mission au Thibet.
Actuellement, huit chanoines et un frère lai travaillent à l’établissement d’un hospice au col de Latsa qui, à 3800 m. d’altitude, relie les vallées du Mékong et de la Salouen. Cet hospice, dans une situation analogue à celle du Mont-Joux, perpétuera en Asie l’oeuvre de saint Bernard, à l’égard des voyageurs exposés aux dangers de la haute montagne.
Informations sur la Congrégation des Chanoines du Gd-St-Bernard,
voir www.gsbernard.ch et www.gsbernard.net